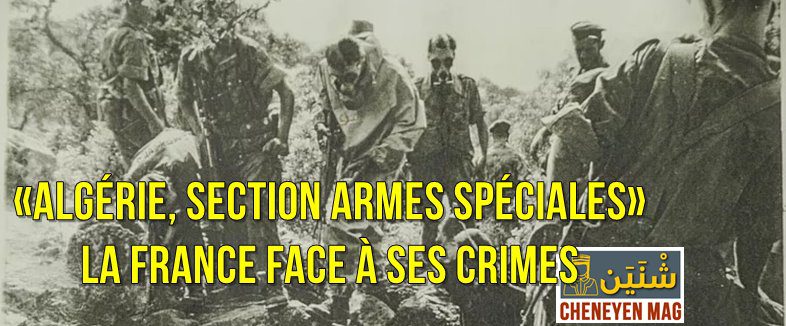Contexte de la déprogrammation du documentaire
Le 11 mars 2025, à cinq jours de sa diffusion prévue sur France 5, le documentaire « Algérie, Section Armes Spéciales » de Christophe Lafaye et Claire Billet a été déprogrammé.
Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre la France et l’Algérie, accentuées par la suspension de Jean-Michel Apathie.
France Télévisions a justifié ce choix en programmant une soirée spéciale États-Unis/Russie, tout en assurant que le documentaire serait disponible sur sa plateforme et reprogrammé ultérieurement, sans préciser de date.
Un précédent article de Cheneyen Magazine avait déjà évoqué cette déprogrammation et ses enjeux (lire ici).

Témoignages poignants des victimes et des soldats
Armand Casanova, ancien membre d’une Section Armes Spéciales en Algérie, se remémore « l’odeur du gaz et de celle de la mort » plus de soixante ans après les faits.
En 1959, face à la montée en puissance de l’Armée Nationale de Libération et à l’utilisation de souterrains par les combattants algériens, l’armée française a recours à des gaz interdits par le protocole de Genève de 1925 pour reprendre l’avantage.
Cette stratégie, potentiellement qualifiable de crime de guerre, reste largement méconnue.
Le documentaire donne également la parole à des Algériens, tels qu’Amar Aggoun et Mohamed ben Slimane Labaaci, qui, adolescents en 1959, ont survécu à une attaque chimique ayant causé la mort de 118 personnes réfugiées dans la grotte de Ghar Ouchetouh.
Enquête sur l’utilisation d’armes chimiques en Algérie
L’historien Christophe Lafaye et la journaliste Claire Billet ont mené une enquête approfondie, révélant que l’armée française a mené une véritable guerre chimique en Algérie.
Leurs travaux mettent en lumière l’existence de la Batterie des Armes Spéciales (BAS) du 411e régiment d’artillerie antiaérienne, créée en décembre 1956 pour mener des expérimentations opérationnelles et employer des techniques et armes spéciales.
Des appelés du contingent ont été formés au 610e Groupe d’expérimentation et d’instruction des armes spéciales (GEIAS) avant de servir en Algérie dans les « sections des grottes ».
Ils ont utilisé des grenades, des chandelles et des roquettes chargées de gaz toxiques, notamment du CN2D, mortel en milieu mi-clos.
Appel à la réconciliation et à la reconnaissance historique
En donnant la parole aux deux côtés de cette histoire, le documentaire établit un dialogue des mémoires, essentiel pour une véritable réconciliation et une reconnaissance des violences de la guerre coloniale.
Malgré l’ouverture des archives en 2012, celles-ci ont été refermées en 2019, compliquant le travail des historiens.
Néanmoins, des documents inédits, tels que l’autorisation politique d’utiliser ces armes interdites, sont portés à la connaissance du public.
Chaque année, le massacre de la grotte de Ghar Ouchetouh est commémoré en Algérie, témoignant de l’importance de cette mémoire collective.