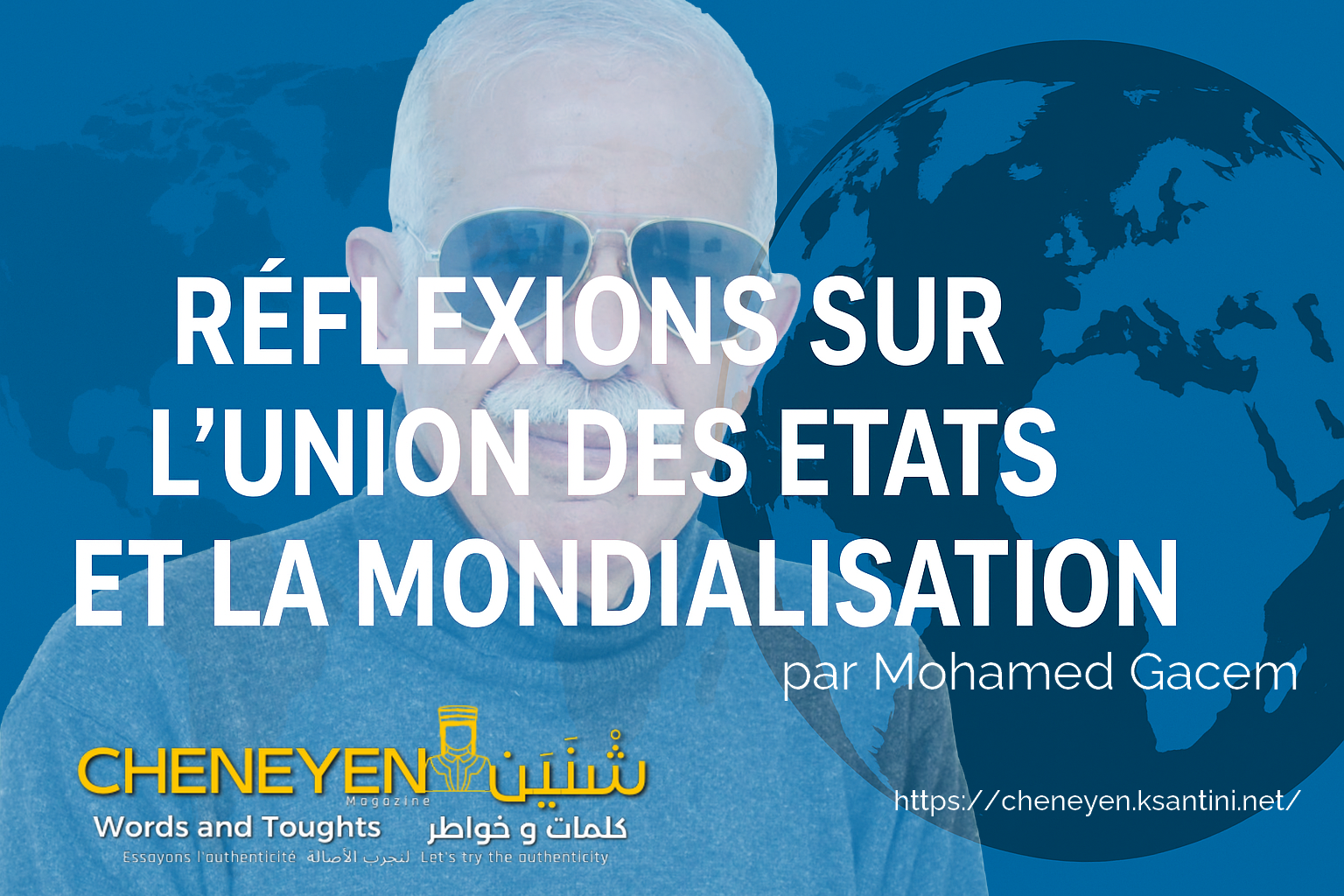Réflexions sur l’union des États et la mondialisation
Depuis le début de l’ère chrétienne et l’écriture de l’histoire, deux mille ans se sont écoulés.
Grâce au travail, à la ténacité, à l’intrépidité et au courage de ceux qui nous ont précédés – du rêve de Jules Verne aux premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune – grâce aux libres penseurs, aux hommes de lettres, de l’art et des sciences, à leur quête de vérité, à leur curiosité scientifique et aux dizaines de milliers d’heures consacrées à l’étude et à la recherche, l’humanité a progressé par la science et pour la science.
Grâce aux sacrifices consentis – du martyr de Galilée à celui de Gagarine – par une minorité d’hommes et de femmes dévoués et attachés au bien-être de l’humanité tout entière, grâce au rayonnement du siècle des Lumières, l’homme a accumulé et capitalisé de grandes connaissances dans de nombreux domaines, profitant à l’ensemble de l’humanité.
Il est ainsi passé de la nuit de l’ignorance à la lumière du savoir, accédant aux progrès considérables des sciences, de la technologie, de l’espace et de l’art, améliorant son confort matériel sans pour autant se vaincre lui-même ni triompher de son égo.
En maîtrisant mieux les deux dimensions que sont l’espace et le temps, l’homme a réduit la planète Terre à la taille d’un village où les cultures et croyances, au lieu de se rapprocher pour se comprendre, continuent à se méfier et se détester.
Des nations qui, hier encore, marquaient leurs territoires comme les fauves et se livraient à des guerres fratricides absurdes, s’unissent aujourd’hui pour former de grands ensembles cohérents.
L’Union européenne a vu le jour grâce à la culture, à la sagesse et au bon sens politique de chefs d’États éclairés, et à la maturité des peuples et des démocraties de ce vieux continent, théâtre de deux guerres mondiales effroyables. Née au début du troisième millénaire, elle est un bon augure, car elle révèle la transcendance du bien sur le mal.
Expurgée de tout préalable religieux, elle représente une percée vers davantage de civilisation et amorce une première victoire de l’homme sur ses préjugés et ses pulsions négatives.
L’union des États de la nation arabe, préfigurée par une Ligue arabe timorée, constitue un ensemble cohérent cimenté par une même langue, une même histoire, une même religion, une même culture et une communauté de destin. Elle reste cependant un vœu pieux qui ne saurait se réaliser sans le règlement de l’épineux problème israélo-palestinien, sans la disparition des théocraties et des dictatures, et sans l’introduction dans les mœurs d’idées novatrices aptes à favoriser le progrès spirituel et la maturation des comportements.
D’autres ensembles partageant un même espace géographique, une histoire et une culture communes, liés par un avenir commun, se dessinent timidement : l’union des États d’Afrique, celle du sud du continent américain, ou encore celle des pays asiatiques et océaniques.
Les autocraties et dictatures du monde utilisent encore, en ce début du troisième millénaire, des systèmes archaïques, violents et répressifs, une justice sommaire héritée du Moyen Âge, fondée sur des concepts raciaux ou idéologiques poussiéreux. Ces régimes briment les populations, en particulier les femmes et les minorités, les maintenant dans un conservatisme déshumanisant.
Leurs dirigeants – despotes avérés, imposés, indéracinables et quasi séculaires – sont des jouisseurs mégalomanes et paranoïaques que des lois internationales devraient interdire de siéger aux Nations unies.
« En maîtrisant mieux les deux dimensions que sont l’espace et le temps, l’homme a réduit la planète Terre à la taille d’un village où les cultures et croyances, au lieu de se rapprocher pour se comprendre, continuent à se méfier et se détester. »
— Mohammed Gacem
La mondialisation : fatalité ou espoir ?
La mondialisation, d’une brûlante actualité, semble être une fatalité planifiée par les superpuissances :
Est-elle la résurgence d’un néocolonialisme qui ne dit pas son nom, véhiculant les relents d’une nouvelle domination planétaire, limitée à des concepts mercantiles ?
Ou bien s’impose-t-elle pour humaniser le monde, soigner ses plaies et réduire les écarts entre riches et pauvres ?
Espérons cette seconde vision : une mondialisation qui rapprocherait les peuples, initierait les États à la démocratie, veillerait au respect des droits de l’homme et de l’enfant, réduirait les inégalités sociales et répartirait équitablement les richesses.
Elle pourrait surtout fonder une école universelle de la vie, où les enfants de tous les pays apprendraient la politesse, la morale universelle, la tolérance, le civisme, la liberté, la philosophie, l’art, l’esprit critique et l’amour du prochain.
La mondialisation marquerait alors le départ d’une ère de justice, de paix, d’éthique et de convivialité entre les peuples, posant les bases d’un nouvel ordre universel et d’un futur gouvernement fédéral mondial, remplaçant une ONU devenue obsolète. Ce nouvel ordre comprendrait un observatoire universel des religions et des sectes, pour éviter tout dérapage et toute surenchère.
Vision utopique, sans doute, dans un monde où la force prime encore le droit. Mais le rêve étant une faculté humaine, il n’est pas interdit de s’y abandonner un instant, et d’imaginer un monde nouveau et meilleur…
Car si tous les peuples du monde rêvaient intensément d’un idéal commun, celui-ci finirait par s’accomplir, nos réalités n’étant que le fruit des efforts et des rêves de ceux qui nous ont précédés.
« Car si tous les peuples du monde rêvaient intensément d’un idéal commun, celui-ci finirait par s’accomplir, nos réalités n’étant que le fruit des efforts et des rêves de ceux qui nous ont précédés. »
— Mohammed Gacem
Mohammed Gacem
Saïda, le 7 octobre 2025